Conserver les légumes plus longtemps
Les légumes sont présents dans notre alimentation, même s’il faut avouer que nous ne les consommons pas toujours. Force est de reconnaître que carotte, chou, aubergine, patate douce, pomme de terre, aubergine amère, courge, navet (surtout !)… finissent souvent dans la poubelle après le déjeuner. Mais bon, là n’est pas le sujet (pas encore).
Nous parlerons plutôt de la conservation des légumes pour éviter les nombreux allers-retours au marché, avoir toujours des légumes frais chez soi et ainsi en consommer plus le soir. En effet, dans les grands marchés de la place, il y a une plus grande variété de légumes et les prix sont plus abordables.
Conservation des Légumes
 Plusieurs techniques de conservation sont applicables à nos légumes du Sénégal. Certaines techniques permettent de prolonger la durée de vie des légumes naturellement, tandis que d’autres font usage du froid. Nous allons passer en revue la plupart des légumes que l’on retrouve sur le marché sénégalais :
Plusieurs techniques de conservation sont applicables à nos légumes du Sénégal. Certaines techniques permettent de prolonger la durée de vie des légumes naturellement, tandis que d’autres font usage du froid. Nous allons passer en revue la plupart des légumes que l’on retrouve sur le marché sénégalais :
- Oignon, ail, patate douce et pomme de terre peuvent se conserver à l’air libre, dans un endroit sec et aéré, à l’abri de la lumière pour éviter la germination. Lorsque les oignons ou les pommes de terre sont humides, il est conseillé de les laisser quelque temps au soleil pour les sécher. La durée de conservation peut être alors de plusieurs mois.
- Tomates : elles peuvent se conserver quelques jours à l’air libre. Il vaut mieux les acheter peu matures. Si elles sont bien mûres, en revanche, préférez le réfrigérateur. Il suffit de les mettre dans un sachet (sans nouer) et de les placer dans le bac à légumes du réfrigérateur. Cette technique fonctionne aussi très bien avec les concombres, aubergines, choux, carottes, navets, radis et poivrons. La durée de conservation peut être alors d’environ 2 semaines.
- Haricots verts : ils se conservent mieux congelés. Il suffit de bien les laver, de les équeuter, de les mettre dans un sachet puis au congélateur. Au moment de les préparer, les plonger directement, ainsi congelés, dans l’eau chaude pour les cuire. C’est aussi la même technique pour les courges, le gombo, le manioc, le piment et la betterave. L’oignon et l’ail se congèlent aussi très bien, mais il faut d’abord découper les oignons et piler l’ail. La durée de conservation peut être de plusieurs mois.
- Herbes aromatiques : la menthe, l’oignon vert, le persil frisé et le persil plat peuvent être conservés dans un bocal contenant de l’eau. En plongeant les tiges dans l’eau, vous leur assurez encore 2 à 3 jours de fraîcheur. Il est aussi possible de les enrouler dans un chiffon humide ou de les sécher (ce qui entraîne par contre une perte d’une partie de leur saveur).
Les Erreurs Courantes à Éviter
- Mélanger les légumes : certains légumes dégagent de l’humidité ou des gaz qui peuvent accélérer la détérioration des autres.
- Laisser les légumes humides : l’humidité favorise le développement des moisissures, surtout pour les produits stockés à température ambiante.
- Congeler certains légumes : les légumes riches en eau, comme la laitue et le concombre, ne supportent pas la congélation.
- Mettre les légumes directement dans le bac à légumes : pour une plus longue durée de conservation, placez d’abord les légumes dans un sachet.
 Avec ces techniques, vous pourrez conserver efficacement vos légumes, limiter les allers-retours au marché et avoir toujours des légumes frais chez vous.
Avec ces techniques, vous pourrez conserver efficacement vos légumes, limiter les allers-retours au marché et avoir toujours des légumes frais chez vous.

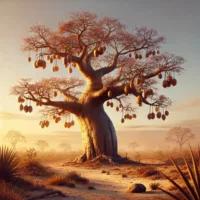 arbre géant emblématique du Sénégal. Il pousse naturellement dans les régions sèches et sahéliennes. Son fruit est récolté entre décembre et mai. Le bouye est tiré des gousses du baobab, qui sont des coques allongées qu’il faut casser pour récupérer le fruit blanc. Avec son gout acidulé et sa saveur légèrement sucrée, le bouye offre un boisson très appréciée au Sénégal. Il entre aussi dans la composition de certaines spécialités locales comme le ngalakh par exemple.
arbre géant emblématique du Sénégal. Il pousse naturellement dans les régions sèches et sahéliennes. Son fruit est récolté entre décembre et mai. Le bouye est tiré des gousses du baobab, qui sont des coques allongées qu’il faut casser pour récupérer le fruit blanc. Avec son gout acidulé et sa saveur légèrement sucrée, le bouye offre un boisson très appréciée au Sénégal. Il entre aussi dans la composition de certaines spécialités locales comme le ngalakh par exemple.



 Au Sénégal, il est communément appelé lait caillé (sow en wolof). Traditionnellement, le lait de vache fraîchement trait caille naturellement dans des ustensiles traditionnels contenant ces micro-organismes qui transforment le lait en lait caillé.
Au Sénégal, il est communément appelé lait caillé (sow en wolof). Traditionnellement, le lait de vache fraîchement trait caille naturellement dans des ustensiles traditionnels contenant ces micro-organismes qui transforment le lait en lait caillé.


 Les produits de cueillette occupent également une place de choix dans le commerce et la consommation des produits classés dans « fruits et légumes ». Ces produits de la cueillette très variés, sont récoltés généralement dans les forêts casamançaises et du Sénégal oriental (même si certaines espèces sont présentes un peu partout sur le territoire national): tamarin, pain de singe (fruits du baobab), madd, jujube, ditakh, etc.
Les produits de cueillette occupent également une place de choix dans le commerce et la consommation des produits classés dans « fruits et légumes ». Ces produits de la cueillette très variés, sont récoltés généralement dans les forêts casamançaises et du Sénégal oriental (même si certaines espèces sont présentes un peu partout sur le territoire national): tamarin, pain de singe (fruits du baobab), madd, jujube, ditakh, etc.


 transmission de la lèpre par le lait et la viande de chèvre.Du lait de chèvre est produit,transformé, commercialisé et consommé dans la région de Fatick suite au travail de sensibilisation du programme.
transmission de la lèpre par le lait et la viande de chèvre.Du lait de chèvre est produit,transformé, commercialisé et consommé dans la région de Fatick suite au travail de sensibilisation du programme.
 t des stocks fourragers pour alimenter les animaux pendant la période de soudure.
t des stocks fourragers pour alimenter les animaux pendant la période de soudure.


 un approvisionnement régulier pour la Laiterie du Berger qui était la seule unité de transformation de taille industrielle à utiliser du lait local dans sa production (le taux d’incorporation a beaucoup varié durant le projet). Par cette voie le projet contribuait aussi à l’amélioration de l’approvisionnement des villes en produits laitiers locaux tout en favorisant les interactions et collaborations entre les acteurs du département de Dagana.
un approvisionnement régulier pour la Laiterie du Berger qui était la seule unité de transformation de taille industrielle à utiliser du lait local dans sa production (le taux d’incorporation a beaucoup varié durant le projet). Par cette voie le projet contribuait aussi à l’amélioration de l’approvisionnement des villes en produits laitiers locaux tout en favorisant les interactions et collaborations entre les acteurs du département de Dagana. d’organisations professionnelles
d’organisations professionnelles


 A travers différents projets (Prolait et Profils, Milky way to development, Galo), le Gret a renforcé les mini-laiteries sur le plan technique, économique, financier, commercial et réglementaire. Le but était d’accompagner les unités dans la création d’une entreprise économiquement viable, fabriquer des produits de qualité en répondant aux attentes du marché, dans le respect de la législation en vigueur dans le pays.
A travers différents projets (Prolait et Profils, Milky way to development, Galo), le Gret a renforcé les mini-laiteries sur le plan technique, économique, financier, commercial et réglementaire. Le but était d’accompagner les unités dans la création d’une entreprise économiquement viable, fabriquer des produits de qualité en répondant aux attentes du marché, dans le respect de la législation en vigueur dans le pays.

 La Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale qui a été promulguée le 4 juin 2004 reconnaît, pour la première fois, l’élevage comme une forme de mise en valeur durable des terres.
La Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale qui a été promulguée le 4 juin 2004 reconnaît, pour la première fois, l’élevage comme une forme de mise en valeur durable des terres. Plusieurs structures sont concernées par le contrôle de la transformation et de la commercialisation des denrées alimentaires au Sénégal.
Plusieurs structures sont concernées par le contrôle de la transformation et de la commercialisation des denrées alimentaires au Sénégal. Plusieurs normes sénégalaises portent sur des produits laitiers (lait en poudre, lait fermentés, lait cru, lait pasteurisé, lait stérilisé, yaourt, laits concentrés) mais elles ne sont pas obligatoires en raison de l’absence de décrets d’application, et souvent anciennes et inadaptées.
Plusieurs normes sénégalaises portent sur des produits laitiers (lait en poudre, lait fermentés, lait cru, lait pasteurisé, lait stérilisé, yaourt, laits concentrés) mais elles ne sont pas obligatoires en raison de l’absence de décrets d’application, et souvent anciennes et inadaptées.




